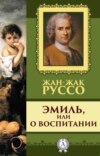Читать книгу: «Les confessions», страница 47
Le traité était conclu, non encore signé, quand les Lettres écrites de la Montagne parurent. La terrible explosion qui se fit contre cet infernal ouvrage et contre son abominable auteur, épouvanta la compagnie, et l’entreprise s’évanouit. Je comparais l’effet de ce dernier ouvrage à celui de la Lettre sur la Musique française, si cette lettre, en m’attirant la haine et m’exposant au péril, ne m’eût laissé du moins la considération et l’estime. Mais, après ce dernier ouvrage, on parut s’étonner à Genève et à Versailles qu’on laissât respirer un monstre tel que moi. Le petit Conseil, excité par le Résident de France, et dirigé par le Procureur général, donna une déclaration sur mon ouvrage, par laquelle, avec les qualifications les plus atroces, il le déclare indigne d’être brûlé par le bourreau, et ajoute avec une adresse qui tient du burlesque qu’on ne peut, sans se déshonorer, y répondre ni même en faire aucune mention. Je voudrais pouvoir transcrire ici cette curieuse pièce; mais malheureusement je ne l’ai pas et ne m’en souviens pas d’un seul mot. Je désire ardemment que quelqu’un de mes lecteurs, animé du zèle de la vérité et de l’équité veuille relire en entier les Lettres écrites de la Montagne; il sentira, j’ose le dire, la stoïque modération dans cet ouvrage, après les sensibles et cruels outrages dont on venait à l’envi d’accabler l’auteur. Mais, ne pouvant répondre aux injures, parce qu’il n’y en avait point, ni aux raisons, parce qu’elles étaient sans réponse, ils prirent le parti de paraître trop courroucés pour vouloir répondre, et il est vrai que s’ils prenaient les arguments invincibles pour des injures ils devaient se tenir fort injuriés.
Les représentants, loin de faire aucune plainte sur cette odieuse déclaration, suivirent la route qu’elle leur traçait, et au lieu de faire trophée des Lettres de la Montagne, qu’ils voilèrent pour s’en faire un bouclier, ils eurent la lâcheté de ne rendre ni honneur ni justice à cet écrit fait pour leur défense et à leur sollicitation, ni le citer, ni le nommer, quoiqu’ils en tirassent tacitement tous leurs arguments, et que l’exactitude avec laquelle ils ont suivi le conseil par duquel finit cet ouvrage ait été la seule cause de leur salut et de leur victoire. Ils m’avaient imposé ce devoir; je l’avais rempli; j’avais jusqu’au bout servi la patrie et leur cause. Je les priai d’abandonner la mienne et de ne songer qu’à eux dans leurs démêlés. Ils me prirent au mot et je ne me suis plus mêlé de leurs affaires que pour les exhorter sans cesse à la paix, ne doutant pas que, s’ils s’obstinaient, ils ne fussent écrasés par la France. Cela n’est pas arrivé: j’en comprends la raison, mais ce n’est pas ici le lieu de la dire.
L’effet des Lettres de la Montagne, à Neuchâtel, fut d’abord très paisible. J’en envoyai un exemplaire à M. de Montmollin; il le reçut bien, et le lut sans objection. Il était malade, aussi bien que moi; il me vint voir amicalement quand il fut rétabli, et ne me parla de rien. Cependant la rumeur commençait; on brûla le livre je ne sais où. De Genève, de Berne, et de Versailles peut-être, le foyer de l’effervescence passa bientôt à Neuchâtel, et surtout dans le Val-de-Travers, où, avant même que la classe eût fait aucun mouvement apparent, on avait commencé d’ameuter le peuple par des pratiques souterraines. Je devais, j’ose le dire, être aimé du peuple dans ce pays-là, comme je l’ai été dans tous ceux où j’ai vécu, versant les aumônes à pleines mains, ne laissant sans assistance aucun indigent autour de moi, ne refusant à personne aucun service que je pusse rendre et qui fût dans la justice, me familiarisant trop peut-être avec tout le monde, et me dérobant de tout mon pouvoir à toute distinction qui pût exciter la jalousie. Tout cela n’empêcha pas que la populace, soulevée secrètement je ne sais par qui, ne s’animât contre moi par degrés, jusqu’à la fureur, qu’elle ne m’insultât publiquement en plein jour, non seulement dans la campagne et dans les chemins, mais en pleine rue. Ceux à qui j’avais fait le plus de bien étaient les plus acharnés, et des gens même à qui je continuais d’en faire, n’osant se montrer, excitaient les autres, et semblaient vouloir se venger ainsi de l’humiliation de m’être obligés. Montmollin paraissait ne rien voir, et ne se montrait pas encore. Mais, comme on approchait d’un temps de communion, il vint chez moi pour me conseiller de m’abstenir de m’y présenter, m’assurant que du reste il ne m’en voulait point, et qu’il me laisserait tranquille. Je trouvai le compliment bizarre; il me rappelait la lettre de Mme de Boufflers et je ne pouvais concevoir à qui donc il importait si fort que je communiasse ou non. Comme je regardais cette condescendance de ma part comme un acte de lâcheté, et que d’ailleurs je ne voulais pas donner au peuple ce nouveau prétexte de crier à l’impie, je refusai net le ministre, et il s’en retourna mécontent, me faisant entendre que je m’en repentirais.
Il ne pouvait pas m’interdire la communion de sa seule autorité: il fallait celle du Consistoire qui m’avait admis, et tant que le Consistoire n’avait rien dit, je pouvais me présenter hardiment, sans crainte de refus. Montmollin se fit donner par la classe la commission de me citer au Consistoire pour y rendre compte de ma foi, et de m’excommunier en cas de refus. Cette excommunication ne pouvait non plus se faire que par le Consistoire et à la pluralité des voix. Mais les paysans qui, sous le nom d’anciens, composaient cette assemblée, présidés et, comme on comprend bien, gouvernés par leur ministre, ne devaient pas naturellement être d’un autre avis que le sien, principalement sur des matières théologiques, qu’ils entendaient encore moins que lui. Je fus donc cité, et je résolus de comparaître.
Quelle circonstance heureuse, et quel triomphe pour moi, si j’avais su parler, et que j’eusse eu, pour ainsi dire, ma plume dans ma bouche! Avec quelle supériorité, avec quelle facilité j’aurais terrassé ce pauvre ministre au milieu de ses six paysans! L’avidité de dominer ayant fait oublier au clergé protestant tous les principes de la réformation, je n’avais, pour l’y rappeler et le réduire au silence, qu’à commenter mes premières Lettres sur la Montagne, sur lesquelles ils avaient la bêtise de m’épiloguer. Mon texte était tout fait, je n’avais qu’à l’étendre, et mon homme était confondu. Je n’aurais pas été assez sot pour me tenir sur la défensive; il m’était aisé de devenir agresseur sans même qu’il s’en aperçût, ou qu’il pût s’en garantir. Les prestolets de la classe, non moins étourdis qu’ignorants, m’avaient mis eux-mêmes dans la position la plus heureuse que j’aurais pu désirer pour les écraser à plaisir. Mais quoi! il fallait parler et parler sur-le-champ, trouver les idées, les tours, les mots au moment du besoin, avoir toujours l’esprit présent, être toujours de sang-froid, ne jamais me troubler un moment. Que pouvais-je espérer de moi, qui sentais si bien mon inaptitude à m’exprimer impromptu? J’avais été réduit au silence le plus humiliant à Genève devant une assemblée toute en ma faveur, et déjà résolue à tout approuver. Ici, c’était tout le contraire: j’avais affaire à un tracassier, qui mettait l’astuce à la place du savoir, qui me tendrait cent pièges avant que j’en aperçusse un, et tout déterminé à me prendre en faute, à quelque prix que ce fût. Plus j’examinai cette position, plus elle me parut périlleuse de m’en tirer avec succès, j’imaginai un autre président. Je méditai un discours à prononcer devait le Consistoire, pour le récuser et me dispenser de répondre; la chose était très facile. J’écrivis ce discours, et je me mis à l’étudier par cœur avec une ardeur sans égale. Thérèse se moquait de moi, en m’entendant marmotter et répéter incessamment les mêmes phrases, pour tâcher de les fourrer dans ma tête. J’espérais tenir enfin mon discours; je savais que le Châtelain, comme officier du Prince, assisterait au Consistoire, que, malgré les manœuvres et les bouteilles de Montmollin, la plupart des anciens étaient bien disposés pour moi; j’avais en ma faveur la raison, la vérité, la justice, la protection du Roi, l’autorité du Conseil d’État, les vœux de tous les bons patriotes qu’intéressait l’établissement de cette inquisition; tout contribuait à m’encourager.
La veille du jour marqué, je savais mon discours par cœur; je le récitai sans faute. Je le remémorai toute la nuit dans ma tête: le matin je ne le savais plus; j’hésite à chaque mot, je me crois déjà dans l’illustre assemblée, je me trouble, je balbutie, ma tête se perd; enfin, presque au moment d’aller, le courage me manque totalement; je reste chez moi, et je prends le parti d’écrire au Consistoire, en disant mes raisons à la hâte, et prétextant mes incommodités qui, véritablement, dans l’état où j’étais alors, m’auraient difficilement laissé soutenir la séance entière.
Le ministre, embarrassé de ma lettre, remit l’affaire à une autre séance. Dans l’intervalle, il se donna par lui-même et par ses créatures mille mouvements pour séduire ceux des anciens qui, suivant les inspirations de leur conscience plutôt que les siennes, n’opinaient pas au gré de la classe et au sien. Quelque puissants que ses arguments tirés de sa cave dussent être sur ces sortes de gens, il n’en put gagner aucun autre que les deux ou trois qui lui étaient déjà dévoués, et qu’on appelait ses âmes damnées. L’officier du Prince et le colonel Pury, qui se porta dans cette affaire avec beaucoup de zèle, maintinrent les autres dans leur devoir, et quand ce Montmollin voulut procéder à l’excommunication, son Consistoire, à la pluralité des voix, le refusa tout à plat. Réduit alors au dernier expédient d’ameuter la populace, il se mit avec ses confrères et d’autres gens à y travailler ouvertement, et avec un tel succès, que malgré les forts et fréquents rescrits du Roi, malgré tous les ordres du Conseil d’État, je fus enfin forcé de quitter le pays, pour ne pas exposer l’officier du Prince à s’y faire assassiner lui-même en me défendant.
Je n’ai qu’un souvenir si confus de toute cette affaire, qu’il m’est impossible de mettre aucun ordre, aucune liaison dans les idées qui m’en reviennent, et que je ne puis rendre qu’éparses et isolées, comme je me rappelle qu’il y avait eu, avec la classe, quelque espèce de négociation, dont Montmollin avait été l’entremetteur. Il avait feint qu’on craignait que par mes écrits je ne troublasse le repos du pays, à qui l’on s’en prendrait de ma liberté d’écrire. Il m’avait fait entendre que, si je m’engageais à quitter la plume, on serait coulant sur le passé. J’avais déjà pris cet engagement avec moi-même; je ne balançai point à le prendre avec la classe, mais conditionnel, et seulement quant aux matières de religion. Il trouva le moyen d’avoir cet écrit à double, sur quelque changement qu’il exigea la condition ayant été rejetée par la classe, je redemandai mon écrit; il me rendit un des doubles et garda l’autre, prétextant qu’il l’avait égaré. Après cela le peuple, ouvertement excité par les ministres, se moqua des rescrits du Roi, des ordres du Conseil d’État, et ne connut plus de frein. Je fus prêché en chaire, nommé d’Antéchrist, et poursuivi dans la campagne comme un loup-garou. Mon habit d’Arménien servait de renseignement à la populace: j’en sentais cruellement l’inconvénient; mais le quitter dans ces circonstances me semblait une lâcheté. Je ne pus m’y résoudre, et je me promenais tranquillement dans le pays avec mon cafetan et mon bonnet fourré, entouré des huées de la canaille et quelquefois de ses cailloux. Plusieurs fois en passant devant des maisons, j’entendais dire à ceux qui les habitaient: «Apportez-moi un fusil, que je lui tire dessus». Je n’en allais pas plus vite: ils n’en étaient que plus furieux; mais ils s’en tinrent toujours aux menaces, du moins pour l’article des armes à feu.
Durant toute cette fermentation, je ne laissai pas d’avoir deux fort grands plaisirs auxquels je fus fort sensible. Le premier fut de pouvoir faire un acte de reconnaissance par le canal de Milord Maréchal. Tous les honnêtes gens de Neuchâtel, indignés des traitements que j’essuyais et des manœuvres dont j’étais la victime, avaient les ministres en exécration, sentant bien qu’ils suivaient des impulsions étrangères, et qu’ils n’étaient que les satellites d’autres gens qui se cachaient en les faisant agir, et craignant que mon exemple ne tirât à conséquence pour l’établissement d’une véritable inquisition. Les magistrats, et surtout M. Meuron, qui avait succédé à M. d’Ivernois, dans la charge de Procureur général, faisaient tous leur efforts pour me défendre. Le colonel Pury, quoique simple particulier, en fit davantage et réussit mieux.
Ce fut lui qui trouva le moyen de faire bouquer Montmollin dans son Consistoire, en retenant les anciens dans leur devoir. Comme il avait du crédit, il l’employa tant qu’il put pour arrêter la sédition; mais il n’avait que l’autorité des lois, de la justice et de la raison à opposer à celle de l’argent et du vin. La partie n’était pas égale, et dans ce point Montmollin triompha de lui. Cependant sensible à ses soins et à son zèle, j’aurais voulu pouvoir lui rendre bon office pour bon office, et pouvoir m’acquitter avec lui de quelque façon. Je savais qu’il convoitait fort une place de conseiller d’État; mais, s’étant mal conduit au gré de la cour, dans l’affaire du ministre Petitpierre, il était en disgrâce auprès du Prince et du Gouverneur. Je risquai pourtant d’écrire en sa faveur à Milord Maréchal; j’osai même parler de l’emploi qu’il désirait, et si heureusement, que, contre l’attente de tout le monde, il lui fut presque aussitôt conféré par le Roi. C’est ainsi que le sort, qui m’a toujours mis en même temps trop haut et trop bas, continuait à me ballotter d’une extrémité à l’autre, et tandis que la populace me couvrait de fange, je faisais un conseiller d’État.
Mon autre grand plaisir fut une visite que vint me faire Mme de Verdelin avec sa fille qu’elle avait menée aux bains de Bourbonne, d’où elle poussa jusqu’à Motiers, et logea chez moi deux ou trois jours. À force d’attentions et de soins, elle avait enfin surmonté ma longue répugnance, et mon cœur, vaincu par ses caresses, lui rendait toute l’amitié qu’elle m’avait si longtemps témoignée. Je fus touché de ce voyage, surtout dans la circonstance où je me trouvais, et où j’avais grand besoin, pour soutenir mon courage, des consolations de l’amitié. Je craignais qu’elle ne s’affectât des insultes que je recevais de la populace, et j’aurais voulu lui en dérober le spectacle pour ne pas contrister son cœur: mais cela ne me fut pas possible, et quoique sa présence contint un peu les insolents dans nos promenades, elle en vit assez pour juger de ce qui se passait dans les autres temps. Ce fut même durant son séjour chez moi que je continuai d’être attaqué de nuit dans ma propre habitation. Sa femme de chambre trouva ma fenêtre couverte un matin des pierres qu’on y avait jetées pendant la nuit. Un banc très massif, qui était dans la rue à côté de ma porte et fortement attaché, fut détaché, enlevé, et posé debout contre la porte, de sorte que, si l’on ne s’en fût aperçu, le premier qui, pour sortir, aurait ouvert la porte d’entrée, devait naturellement être assommé. Mme de Verdelin n’ignorait rien de ce qui se passait; car, outre ce qu’elle voyait elle-même, son domestique, homme de confiance, était très répandu dans le village, y accostait tout le monde, et on le vit même en conférence avec Montmollin. Cependant elle ne parut faire aucune attention à rien de ce qui m’arrivait, ne me parla ni de Montmollin ni de personne, et répondit peu de chose à ce que je lui en dis quelquefois. Seulement, paraissant persuadée que le séjour de l’Angleterre me convenait plus qu’aucun autre, elle me parla beaucoup de M. Hume qui était alors à Paris, de son amitié pour moi, du désir qu’il avait de m’être utile dans son pays. Il est temps de dire quelque chose de ce M. Hume.
Il s’était acquis une grande réputation en France, et surtout parmi les Encyclopédistes, par ses traités de commerce et de politique, et en dernier lieu par son Histoire de la maison Stuart, le seul de ses écrits dont j’avais lu quelque chose dans la traduction de l’abbé Prévost. Faute d’avoir lu ses autres ouvrages, j’étais persuadé, sur ce qu’on m’avait dit de lui, que M. Hume associait une âme très républicaine aux paradoxes anglais en faveur du luxe. Sur cette opinion, je regardais toute son apologie de Charles Ier comme un prodige d’impartialité, et j’avais une aussi grande idée de sa vertu que de son génie. Le désir de connaître cet homme rare et d’obtenir son amitié avait beaucoup augmenté les tentations de passer en Angleterre que me donnaient les sollicitations de Mme de Boufflers, intime amie de M. Hume. Arrivé en Suisse, j’y reçus de lui, par la voie de cette dame, une lettre extrêmement flatteuse, dans laquelle, aux plus grandes louanges sur mon génie, il joignait la pressante invitation de passer en Angleterre, et l’offre de tout son crédit et de tous ses amis pour m’en rendre le séjour agréable. Je trouvai sur les lieux Milord Maréchal, le compatriote et l’ami de M. Hume, qui me confirma tout le bien que j’en pensais, et qui m’apprit même à son sujet une anecdote littéraire qui l’avait beaucoup frappé, et qui me frappa de même. Wallace, qui avait écrit contre Hume au sujet de la population des anciens, était absent tandis qu’on imprimait son ouvrage. Hume se chargea de revoir les épreuves et de veiller à l’édition. Cette conduite était dans mon tour d’esprit. C’est ainsi que j’avais débité des copies à six sols pièce d’une chanson qu’on avait faite contre moi. J’avais donc toutes sortes de préjugés en faveur de Hume, quand Mme de Verdelin vint me parler vivement de l’amitié qu’il disait avoir pour moi, et de son empressement à me faire les honneurs de l’Angleterre; car c’est ainsi qu’elle s’exprimait. Elle me pressa beaucoup de profiter de ce zèle, et d’écrire à M. Hume. Comme je n’avais pas naturellement de penchant pour l’Angleterre, et que je ne voulais prendre ce parti qu’à l’extrémité, je refusai d’écrire et de promettre; mais je la laissai la maîtresse de faire tout ce qu’elle jugerait à propos pour maintenir Hume dans ses bonnes dispositions. En quittant Motiers, elle me laissa persuadé, par tout ce qu’elle m’avait dit de cet homme illustre, qu’il était de mes amis, et qu’elle était encore plus de ses amies.
Après son départ, Montmollin poussa ses manœuvres, et la populace ne connut plus de frein. Je continuais cependant à me promener tranquillement au milieu des huées, et le goût de la botanique, que j’avais commencé de prendre auprès du docteur d’Ivernois, donnant un nouvel intérêt à mes promenades, me faisait parcourir le pays en herborisant, sans m’émouvoir des clameurs de toute cette canaille, dont ce sang-froid ne faisait qu’irriter la fureur. Une des choses qui m’affectèrent le plus fut de voir les familles de mes amis, ou des gens qui portaient ce nom, entrer assez ouvertement dans la ligne de mes persécuteurs, comme les d’Ivernois, sans en excepter même le père et le frère de mon Isabelle, Boy de la Tour, parent de l’amie chez qui j’étais logé, et Girardier, sa belle-sœur. Ce Pierre Boy était si butor, si bête, et se comporta si brutalement, que, pour ne pas me mettre en colère, je me permis de le plaisanter, et je fis, dans le goût du Petit Prophète, une petite brochure de quelques pages, intitulée La Vision de Pierre de la Montagne, dit le Voyant, dans laquelle je trouvai le moyen de tirer assez plaisamment sur les miracles qui faisaient alors le grand prétexte de ma persécution. Du Peyrou fit imprimer à Genève ce chiffon, qui n’eut dans le pays qu’un succès médiocre; les Neuchâtelois, avec tout leur esprit, ne sentent guère le sel attique ni la plaisanterie, sitôt qu’elle est un peu fine.
Je mis un peu plus de soin à un autre écrit du même temps, dont on trouvera le manuscrit parmi mes papiers, et dont il faut dire ici le sujet.
Dans la plus grande fureur des décrets et de la persécution, les Genevois s’étaient particulièrement signalés, en criant haro de toute leur force, et mon ami Vernes, entre autres, avec une générosité vraiment théologique, choisit précisément ce temps-là pour publier contre moi des lettres où il prétendait prouver que je n’étais pas chrétien. Ces lettres, écrites avec un ton de suffisance, n’en étaient pas meilleures, quoiqu’on assurât que le naturaliste Bonnet y avait mis la main: car ledit Bonnet, quoique matérialiste, ne laisse pas d’être d’une orthodoxie très intolérante, sitôt qu’il s’agit de moi. Je ne fus assurément pas tenté de répondre à cet ouvrage; mais l’occasion s’étant présentée d’en dire un mot dans les Lettres de la Montagne, j’y insérai une petite note assez dédaigneuse, qui mit Vernes en fureur. Il remplit Genève des cris de sa rage, et d’Ivernois me marqua qu’il ne se possédait pas. Quelque temps après parut une feuille anonyme, qui semblait écrite, au lieu d’encre, avec l’eau du Phlégéton. On m’accusait dans cette lettre, d’avoir exposé mes enfants dans les rues, de traîner après moi une coureuse de corps de garde, d’être usé de débauche, pourri de vérole, et d’autres gentillesses semblables. Il ne me fut pas difficile de reconnaître mon homme. Ma première idée, à la lecture de ce libelle, fut de mettre à son vrai prix tout ce qu’on appelle renommée et réputation parmi les hommes, en voyant traiter de coureur de bordels un homme qui n’y fut de sa vie, et dont le plus grand défaut fut toujours d’être timide et honteux comme une vierge, et en me voyant passer pour être pourri de vérole, moi qui non seulement n’eus de mes jours la moindre atteinte d’aucun mal de cette espèce, mais que des gens de l’art ont même cru conforme de manière à n’en pouvoir contracter. Tout bien pesé, je crus ne pouvoir mieux réfuter ce libelle qu’en le faisant imprimer dans la ville où j’avais le plus vécu, et je l’envoyai à Duchesne pour le faire imprimer tel qu’il était, avec un avertissement où je nommais M. Vernes, et quelques courtes notes pour l’éclaircissement des faits. Non content d’avoir fait imprimer cette feuille, je l’envoyai à plusieurs personnes, et entre autres à M. le prince Louis de Wurtemberg, qui m’avait fait des avances très honnêtes, et avec lequel j’étais alors en correspondance. Ce prince, du Peyrou et d’autres, parurent douter que Vernes fût l’auteur du libelle, et me blâmèrent de l’avoir nommé trop légèrement. Sur leurs représentations, le scrupule me prit, et j’écrivis à Duchesne de supprimer cette feuille. Guy m’écrivit l’avoir supprimée, je ne sais pas s’il l’a fait, je l’ai trouvé menteur en tant d’occasions, que celle-là de plus ne serait pas une merveille; et dès lors j’étais enveloppé de ces profondes ténèbres à travers lesquelles il m’est impossible de pénétrer aucune sorte de vérité.
M. Vernes supporta cette imputation avec une modération plus qu’étonnante dans un homme qui ne l’aurait pas méritée après la fureur qu’il avait montrée auparavant. Il m’écrivit deux ou trois lettres très mesurées, dont le but me parut être de tâcher de pénétrer, par mes réponses, à quel point j’étais instruit, et si j’avais quelque preuve contre lui. Je lui fis deux réponses courtes, sèches, dures dans le sens, mais sans malhonnêteté dans les termes, et dont il ne se fâcha point. À sa troisième lettre, voyant qu’il voulait lier une espèce de correspondance, je ne répondis plus: il me fit parler par d’Ivernois. Mme Cramer écrivit à du Peyrou qu’elle était sûre que le libelle n’était pas de Vernes. Tout cela n’ébranla point ma persuasion; mais comme enfin je pouvais me tromper, et qu’en ce cas je devais à Vernes une réparation authentique, je lui fis dire par d’Ivernois que je la lui ferais telle qu’il en serait content, s’il pouvait m’indiquer le véritable auteur du libelle, ou me prouver du moins qu’il ne l’était pas. Je fis plus: sentant bien qu’après tout, s’il n’était pas coupable, je n’avais pas droit d’exiger qu’il me prouvât rien, je pris le parti d’écrire, dans un mémoire assez ample, les raisons de ma persuasion, et de les soumettre au jugement d’un arbitre que Vernes ne pût récuser. On ne devinerait pas quel fut cet arbitre que je choisis. [Le Conseil de Genève]. Je déclarai à la fin du Mémoire que si, après l’avoir examiné et fait les perquisitions qu’il jugerait nécessaires, et qu’il était bien à portée de faire avec succès, le Conseil prononçait que M. Vernes n’était pas l’auteur du mémoire, dès l’instant je cesserais sincèrement de croire qu’il l’est, je partirais pour m’aller jeter à ses pieds, et lui demander pardon jusqu’à ce que je l’eusse obtenu. J’ose le dire, jamais mon zèle ardent pour l’équité, jamais la droiture, la générosité de mon âme, jamais ma confiance dans cet amour de la justice, inné dans tous les cœurs, ne se montrèrent plus pleinement, plus sensiblement que dans ce sage et touchant mémoire, où je prenais sans hésiter mes plus implacables ennemis pour arbitres entre le calomniateur et moi. Je lus cet écrit à du Peyrou: il fut d’avis de le supprimer, et je le supprimai. Il me conseilla d’attendre les preuves que Vernes promettait; je les attendis, et je les attends encore: il me conseilla de me taire en attendant; je me tus, et me tairai le reste de ma vie, blâmé d’avoir chargé Vernes d’une imputation grave, fausse et sans preuve, quoique je reste intérieurement persuadé, convaincu, comme de ma propre existence, qu’il est l’auteur du libelle. Mon Mémoire est entre les mains de M. du Peyrou. Si jamais il voit le jour, on y trouvera mes raisons, et l’on y connaîtra, je l’espère, l’âme de Jean-Jacques, que mes contemporains ont si peu voulu connaître.
Il est temps d’en venir à ma catastrophe de Motiers, et à mon départ du Val-de-Travers, après deux ans et demi de séjour, et huit mois d’une constance inébranlable à souffrir les plus indignes traitements. Il m’est impossible de me rappeler nettement les détails de cette désagréable époque; mais on les trouvera dans la relation qu’en publia du Peyrou, et dont j’aurai à parler dans la suite.
Depuis le départ de Mme de Verdelin, la fermentation devenait plus vive, et, malgré les rescrits réitérés du Roi, malgré les ordres fréquents du Conseil d’État, malgré les soins du Châtelain et des magistrats du lieu, le peuple, me regardant tout de bon comme l’Antéchrist, et voyant toutes ses clameurs inutiles, parut enfin vouloir en venir aux voies de fait; déjà dans les chemins les cailloux commençaient à rouler après moi, lancés cependant encore d’un peu trop loin pour pouvoir m’atteindre. Enfin la nuit de la foire de Motiers, qui est au commencement de septembre, je fus attaqué dans ma demeure, de manière à mettre en danger la vie de ceux qui l’habitaient.
À minuit, j’entendis un grand bruit dans la galerie qui régnait sur le derrière de la maison. Une grêle de cailloux, lancés contre la fenêtre et la porte qui donnaient sur cette galerie, y tombèrent avec tant de fracas, que mon chien, qui couchait dans la galerie, et qui avait commencé par aboyer, se tut de frayeur, et se sauva dans un coin, rongeant et grattant les planches pour tâcher de fuir. Je me lève au bruit; j’allais sortir de ma chambre pour passer dans la cuisine, quand un caillou lancé d’une main vigoureuse traversa la cuisine, après en avoir cassé la fenêtre, vint ouvrir la porte de ma chambre et tomber au pied de mon lit; de sorte que, si je m’étais pressé d’une seconde, j’avais le caillou dans l’estomac. Je jugeai que le bruit avait été fait pour m’attirer, et le caillou lancé pour m’accueillir à ma sortie. Je saute dans la cuisine. Je trouve Thérèse, qui s’était aussi levée, et qui toute tremblante accourait à moi. Nous nous rangeons contre un mur, hors de la direction de la fenêtre pour éviter l’atteinte des pierres et délibérer sur ce que nous avions à faire; car sortir pour appeler du secours était le moyen de nous faire assommer. Heureusement, la servante d’un vieux bonhomme qui logeait au-dessous de moi se leva au bruit, et courut appeler M. le Châtelain, dont nous étions porte à porte. Il saute de son lit, prend sa robe de chambre à la hâte, et vient à l’instant avec la garde, qui, à cause de la foire, faisait la ronde cette nuit-là, et se trouva tout à portée. Le Châtelain vit le dégât avec un tel effroi, qu’il en pâlit, et à la vue des cailloux dont la galerie était pleine, il s’écria: «Mon Dieu! c’est une carrière!» En visitant le bas, on trouva que la porte d’une petite cour avait été forcée, et qu’on avait tenté de pénétrer dans la maison par la galerie. En recherchant pourquoi la garde n’avait point aperçu ou empêché le désordre, il se trouva que ceux de Motiers s’étaient obstinés à vouloir faire cette garde hors de leur rang, quoique ce fût le tour d’un autre village. Le lendemain le Châtelain envoya son rapport au Conseil d’État, qui deux jours après lui envoya l’ordre d’informer sur cette affaire, de promettre une récompense et le secret à ceux qui dénonceraient les coupables, et de mettre en attendant, aux frais du Prince, des gardes à ma maison et à celle du Châtelain qui la touchait. Le lendemain, le colonel Pury, le procureur général Meuron, le châtelain Martinet, le receveur Guyenet, le trésorier d’Ivernois et son père, en un mot tout ce qu’il y avait de gens distingués dans le pays, vinrent me voir, et réunirent leurs sollicitations pour m’engager à céder à l’orage, et à sortir au moins pour un temps d’une paroisse où je ne pouvais plus vivre en sûreté, ni avec honneur. Je m’aperçus même que le Châtelain, effrayé des fureurs de ce peuple forcené, et craignant qu’elles ne s’étendissent jusqu’à lui, aurait été bien aise de m’en voir partir au plus vite, pour n’avoir plus l’embarras de m’y protéger, et pouvoir la quitter lui-même, comme il fit après mon départ. Je cédai donc, et même avec peu de peine; car le spectacle de la haine du peuple me causait un déchirement de cœur que je ne pouvais plus supporter.
J’avais plus d’une retraite à choisir. Depuis le retour de Mme de Verdelin à Paris, elle m’avait parlé dans plusieurs lettres d’un M. Walpole qu’elle appelait Milord, lequel, pris d’un grand zèle en ma faveur, me proposait, dans une de ses terres, un asile dont elle me faisait les descriptions les plus agréables, entrant, par rapport au logement et à la subsistance, dans des détails qui marquaient à quel point ledit Milord Walpole s’occupait avec elle de ce projet. Milord Maréchal m’avait toujours conseillé l’Angleterre ou l’Écosse, et m’y offrait aussi un asile dans ses terres; mais il m’en offrait un qui me tentait beaucoup davantage à Potsdam, auprès de lui. Il venait de me faire part d’un propos que le Roi lui avait tenu à mon sujet, et qui était une espèce d’invitation de m’y rendre, et Mme la duchesse de Saxe-Gotha comptait si bien sur ce voyage, qu’elle m’écrivit pour me presser d’aller la voir en passant, et de m’arrêter quelque temps auprès d’elle; mais j’avais un tel attachement pour la Suisse, que je ne pouvais me résoudre à la quitter, tant qu’il me serait possible d’y vivre, et je pris ce temps pour exécuter un projet dont j’étais occupé depuis quelques mois, et dont je n’ai pu parler encore pour ne pas couper le fil de mon récit.