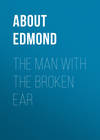Читать книгу: «Le nez d'un notaire»
A M. ALEXANDRE BIXIO
Permettez-moi, monsieur, d’inscrire en tête de ce petit livre le nom cher et honoré d’un homme qui a consacré toute sa vie à la cause du progrès, d’un père qui a offert ses deux fils à la délivrance de l’Italie, d’un ami qui est venu entre les premiers me donner une preuve de sympathie le lendemain de «Gaëtana».
E. A.
I
L’ORIENT ET L’OCCIDENT SONT AUX PRISES: LE SANG COULE
MAÎTRE ALFRED L’AMBERT, avant le coup fatal qui le contraignit à changer de nez, était assurément le plus brillant notaire de France. En ce temps-là, il avait trente-deux ans; sa taille était noble, ses yeux grands et bien fendus; son front olympien, sa barbe et ses cheveux du blond le plus aimable. Son nez (premier du nom) se recourbait en bec d’aigle. Me croira qui voudra, mais la cravate blanche lui allait dans la perfection. Est-ce parce qu’il la portait depuis l’âge le plus tendre, ou parce qu’il se fournissait chez la bonne faiseuse? Je suppose que c’était pour ces deux raisons à la fois.
Autre chose est de se nouer autour du cou un mouchoir de poche roulé en corde; autre chose de former avec art un beau nœud de batiste blanche dont les deux bouts égaux, empesés sans excès, se dirigent symétriquement vers la droite et la gauche. Une cravate blanche bien choisie et bien nouée n’est pas un ornement sans grâce; toutes les dames vous le diront. Mais il ne suffit point de la mettre; il faut encore la bien porter: c’est une affaire d’expérience. Pourquoi les ouvriers paraissent-ils si gauches et si empruntés le jour de leurs noces? Parce qu’ils se sont affublés d’une cravate blanche sans aucune étude préparatoire.
On s’accoutume en un rien de temps à porter les coiffures les plus exorbitantes; une couronne, par exemple. Le soldat Bonaparte en ramassa une que le roi de France avait laissé tomber sur la place Louis XV. Il s’en coiffa lui-même, sans avoir pris leçon de personne, et l’Europe déclara qu’un tel bonnet ne lui allait pas mal. Bientôt même il mit la couronne à la mode dans le cercle de sa famille et de ses amis intimes. Tout le monde autour de lui la portait ou la voulait porter. Mais cet homme extraordinaire ne fut jamais qu’un porte-cravate assez médiocre. M. le vicomte de C***, auteur de plusieurs poèmes en prose, avait étudié la diplomatie, ou l’art de se cravater avec fruit.
Il assista, en 1815, à la revue de notre dernière armée, quelques jours avant la campagne de Waterloo. Savez-vous ce qui frappa son esprit dans cette fête héroïque où éclatait l’enthousiasme désespéré d’un grand peuple? C’est que la cravate de Bonaparte n’allait pas bien.
Peu d’hommes, sur ce terrain pacifique, auraient pu se mesurer avec maître Alfred L’Ambert. Je dis L’Ambert, et non Lambert: il y a décision du conseil d’État. Maître L’Ambert, successeur de son père, exerçait le notariat par droit de naissance. Depuis deux siècles et plus, cette glorieuse famille se transmettait de mâle en mâle l’étude de la rue de Verneuil avec la plus haute clientèle du faubourg Saint-Germain.
La charge n’était pas cotée, n’étant jamais sortie de la famille; mais, d’après le produit des cinq dernières années, on ne pouvait l’estimer moins de trois cent mille écus. C’est dire qu’elle rapportait, bon an, mal an, quatre-vingt-dix mille livres. Depuis deux siècles et plus, tous les aînés de la famille avaient porté la cravate blanche aussi naturellement que les corbeaux portent la plume noire, les ivrognes le nez rouge, ou les poètes l’habit râpé. Légitime héritier d’un nom et d’une fortune considérables, le jeune Alfred avait sucé les bons principes avec le lait. Il méprisait dûment toutes les nouveautés politiques qui se sont introduites en France depuis la catastrophe de 1789. A ses yeux, la nation française se composait de trois classes: le clergé, la noblesse et le tiers état. Opinion respectable et partagée encore aujourd’hui par un petit nombre de sénateurs. Il se rangeait modestement parmi les premiers du tiers état, non sans quelques prétentions secrètes à la noblesse de robe. Il tenait en profond mépris le gros de la nation française, ce ramassis de paysans et de manœuvres qu’on appelle le peuple, ou la vile multitude. Il les approchait le moins possible, par égard pour son aimable personne, qu’il aimait et soignait passionnément. Svelte, sain et vigoureux comme un brochet de rivière, il était convaincu que ces gens-là sont du fretin de poisson blanc, créé tout exprès par la Providence pour nourrir MM. les brochets.
Charmant homme au demeurant, comme presque tous les égoïstes; estimé au Palais, au cercle, à la chambre des notaires, à la conférence de Saint-Vincent de Paul et à la salle d’armes, beau tireur de pointe et de contre-pointe; beau buveur, amant généreux, tant qu’il avait le cœur pris; ami sûr avec les hommes de son rang; créancier des plus gracieux, tant qu’il touchait les intérêts de son capital; délicat dans ses goûts, recherché dans sa toilette, propre comme un louis neuf, assidu le dimanche aux offices de Saint-Thomas d’Aquin, les lundis, mercredis et vendredis au foyer de l’Opéra, il eût été le plus parfait gentleman de son temps au physique comme au moral, sans une déplorable myopie qui le condamnait à porter des lunettes. Est-il besoin d’ajouter que ses lunettes étaient d’or, et les plus fines, les plus légères, les plus élégantes qu’on eût fabriquées chez le célèbre Mathieu Luna, quai des Orfèvres?
Il ne les portait pas toujours, mais seulement à l’étude ou chez le client, lorsqu’il avait des actes à lire. Croyez que les lundis, mercredis et vendredis, lorsqu’il entrait au foyer de la danse, il avait soin de démasquer ses beaux yeux. Aucun verre biconcave ne voilait alors l’éclat de son regard. Il n’y voyait goutte, j’en conviens, et saluait quelquefois une marcheuse pour une étoile; mais il avait l’air résolu d’un Alexandre entrant à Babylone. Aussi les petites filles du corps de ballet, qui donnent volontiers des sobriquets aux personnes, l’avaient-elles surnommé Vainqueur. Un bon gros Turc, secrétaire à l’ambassade, avait reçu le nom de Tranquille, un conseiller d’État s’appelait Mélancolique; un secrétaire général du ministère de***, vif et brouillon dans ses allures, se nommait M. Turlu. C’est pourquoi la petite Élise Champagne, dite aussi Champagne IIe, reçut le nom de Turlurette lorsqu’elle sortit des coryphées pour s’élever au rang de sujet.
Mes lecteurs de province (si tant est que ce récit dépasse jamais les fortifications de Paris) vont méditer une minute ou deux sur le paragraphe qui précède. J’entends d’ici les mille et une questions qu’ils adressent mentalement à l’auteur. «Qu’est-ce que le foyer de la danse? Et le corps de ballet? Et les étoiles de l’Opéra? Et les coryphées? Et les sujets? Et les marcheuses? Et les secrétaires généraux qui s’égarent dans un tel monde, au risque d’y attraper des sobriquets! Enfin par quel hasard un homme posé, un homme rangé, un homme de principes, comme maître Alfred L’Ambert, se trouvait-il trois fois par semaine au foyer de la danse?»
Eh! chers amis, c’est précisément parce qu’il était un homme posé, un homme rangé et un homme de principes. Le foyer de la danse était alors un vaste salon carré, entouré de vieilles banquettes de velours rouge et peuplé de tous les hommes les plus considérables de Paris. On y rencontrait non seulement des financiers, des conseillers d’État, des secrétaires généraux, mais encore des ducs et des princes, des députés, des préfets, et les sénateurs les plus dévoués au pouvoir temporel du pape; il n’y manquait que des prélats. On y voyait des ministres mariés, et même les plus complètement mariés entre tous nos ministres. Quand je dis on y voyait, ce n’est pas que je les aie vus moi-même; vous pensez bien que les pauvres diables de journalistes n’entraient pas là comme au moulin. Un ministre tenait en main les clefs de ce salon des Hespérides; nul n’y pénétrait sans l’aveu de Son Excellence. Aussi fallait-il voir les rivalités, les jalousies et les intrigues! Combien de cabinets on a culbutés sous les prétextes les plus divers, mais au fond parce que tous les hommes d’État veulent régner sur le foyer de la danse! N’allez pas croire au moins que ces personnages y fussent attirés par l’appât des plaisirs défendus! Ils brûlaient d’encourager un art éminemment aristocratique et politique.
La marche des années a peut-être changé tout cela, car les aventures de maître L’Ambert ne datent point de cette semaine. Elles ne remontent pourtant pas à l’antiquité la plus reculée. Mais des raisons de haute convenance me défendent de préciser l’année exacte où cet officier ministériel échangea son nez aquilin contre un nez droit. C’est pourquoi j’ai dit vaguement en ce temps-là, comme les fabulistes. Contentez-vous de savoir que l’action se place, dans les annales du monde, entre l’incendie de Troie par les Grecs et l’incendie du palais d’Été à Pékin par l’armée anglaise, deux mémorables étapes de la civilisation européenne.
Un contemporain et un client de maître L’Ambert, M. le marquis d’Ombremule, disait un soir au café Anglais:
– Ce qui nous distingue du commun des hommes, c’est notre fanatisme pour la danse. La canaille raffole de musique. Elle bat des mains aux opéras de Rossini, de Donizetti et d’Auber: il paraît qu’un million de petites notes mises en salade a quelque chose qui flatte l’oreille de ces gens-là. Ils poussent le ridicule jusqu’à chanter eux-mêmes de leur grosse voix éraillée, et la police leur permet de se réunir dans certains amphithéâtres pour écorcher quelques ariettes. Grand bien leur fasse! Quant à moi, je n’écoute point un opéra, je le regarde: j’arrive pour le divertissement, et je me sauve après. Ma respectable aïeule m’a conté que toutes les grandes dames de son temps n’allaient à l’Opéra que pour le ballet. Elles ne refusaient aucun encouragement à MM. les danseurs. Notre tour est venu; c’est nous qui protégeons les danseuses: honni soit qui mal y pense!
La petite duchesse de Biétry, jeune, jolie et délaissée, eut la faiblesse de reprocher à son mari les habitudes d’Opéra qu’il avait prises.
– N’êtes-vous pas honteux, lui disait-elle, de m’abandonner dans ma loge avec tous vos amis pour courir je ne sais où?
– Madame, répondit-il, lorsqu’on espère une ambassade, ne doit-on pas étudier la politique?
– Soit; mais il y a, je pense, de meilleures écoles dans Paris.
– Aucune. Apprenez, ma chère enfant, que la danse et la politique sont jumelles. Chercher à plaire, courtiser le public, avoir l’œil sur le chef d’orchestre, composer son visage, changer à chaque instant de couleur et d’habit, sauter de gauche à droite et de droite à gauche, se retourner lestement, retomber sur ses pieds, sourire avec des larmes plein les yeux, n’est-ce pas en quelques mots le programme de la danse et de la politique?
La duchesse sourit, pardonna, et prit un amant.
Les grands seigneurs comme le duc de Biétry, les hommes d’État comme le baron de F … les gros millionnaires comme le petit M. St … et les simples notaires comme le héros de cette histoire se coudoient pêle-mêle au foyer de la danse et dans les coulisses du théâtre. Ils sont tous égaux devant l’ignorance et la naïveté de ces quatre-vingts petites ingénues qui composent le corps de ballet. On les appelle MM. les abonnés, on leur sourit gratis, on bavarde avec eux dans les petits coins, on accepte leurs bonbons et même leurs diamants comme des politesses sans conséquence et qui n’engagent à rien celle qui les reçoit. Le monde s’imagine bien à tort que l’Opéra est un marché de plaisir facile et une école de libertinage. On y trouve des vertus en plus grand nombre que dans aucun autre théâtre de Paris: et pourquoi? parce que la vertu y est plus chère que partout ailleurs.
N’est-il pas intéressant d’étudier de près ce petit peuple de jeunes filles, presque toutes parties de fort bas et que le talent ou la beauté peut en un rien de temps élever assez haut? Fillettes de quatorze à seize ans pour la plupart, nourries de pain sec et de pommes vertes dans une mansarde d’ouvrière ou dans une loge de concierge, elles viennent au théâtre en tartan et en savates et courent s’habiller furtivement. Un quart d’heure après, elles descendent au foyer radieuses, étincelantes, couvertes de soie, de gaze et de fleurs, le tout aux frais de l’État, et plus brillantes que les fées, les anges et les houris de nos rêves. Les ministres et les princes leur baisent les mains et blanchissent leur habit noir à la céruse de leurs bras nus. On leur débite à l’oreille des madrigaux vieux et neufs qu’elles comprennent quelquefois. Quelques-unes ont de l’esprit naturel et causent bien; celles-là, on se les arrache.
Un coup de sonnette appelle les fées au théâtre; la foule des abonnés les poursuit jusqu’à l’entrée de la scène, les retient et les accapare derrière les portants de coulisses. Vertueux abonné qui brave la chute des décors, les taches d’huile des quinquets et les miasmes les plus divers pour le plaisir d’entendre une petite voix légèrement enrouée murmurer ces mots charmants:
– Cré nom! j’ai-t-il mal aux pieds!
La toile se lève, et les quatre-vingts reines d’une heure s’ébattent joyeusement sous les lorgnettes d’un public enflammé. Il n’y en a pas une qui ne voie ou ne devine dans la salle deux, trois, dix adorateurs connus ou inconnus. Quelle fête pour elles jusqu’à la chute du rideau! Elles sont jolies, parées, lorgnées, admirées, et elles n’ont rien à craindre de la critique ni des sifflets.
Minuit sonne: tout change comme dans les féeries. Cendrillon remonte avec sa mère ou sa sœur aînée vers les sommets économiques de Batignolles ou de Montmartre. Elle boite un tantinet, pauvre petite! et elle éclabousse ses bas gris. La bonne et sage mère de famille, qui a placé toutes ses espérances sur la tête de cette enfant, rabâche, chemin faisant, quelques leçons de sagesse:
– Marchez droit dans la vie, ô ma fille, et ne vous laissez jamais choir! ou, si le destin veut absolument qu’un tel malheur vous arrive, ayez soin de tomber sur un lit en bois de rose!
Ces conseils de l’expérience ne sont pas toujours suivis. Le cœur parle quelquefois. On a vu des danseuses épouser des danseurs. On a vu des petites filles, jolies comme la Vénus Anadyomène, économiser cent mille francs de bijoux pour conduire à l’autel un employé à deux mille francs. D’autres abandonnent au hasard le soin de leur avenir, et font le désespoir de leur famille. Celle-ci attend le 10 avril pour disposer de son cœur, parce qu’elle s’est juré à elle-même de rester sage jusqu’à dix-sept ans. Celle-là trouve un protecteur à son goût et n’ose le dire: elle craint la vengeance d’un conseiller référendaire qui a promis de la tuer et de se suicider ensuite si elle aimait un autre que lui. Il plaisantait, comme vous pensez bien, mais on prend les paroles au sérieux dans ce petit monde. Qu’elles sont naïves et ignorantes de tout! on a entendu deux grandes filles de seize ans se disputer sur la noblesse de leur origine et le rang de leurs familles:
– Voyez un peu cette demoiselle! disait la plus grande. Les boucles d’oreilles de sa mère sont en argent, et celles de mon père sont en or!
Maître Alfred L’Ambert, après avoir longtemps voltigé de la brune à la blonde, avait fini par s’éprendre d’une jolie brunette aux yeux bleus. Mademoiselle Victorine Tompain était sage, comme on l’est généralement à l’Opéra, jusqu’à ce qu’on ne le soit plus. Bien élevée d’ailleurs, et incapable de prendre une résolution extrême sans consulter ses parents. Depuis tantôt six mois, elle se voyait serrée d’assez près par le beau notaire et par Ayvaz-Bey, ce gros Turc de vingt-cinq ans que l’on désignait par le sobriquet de Tranquille. L’un et l’autre lui avaient tenu des discours sérieux, où il était question de son avenir. La respectable madame Tompain maintenait sa fille dans un sage milieu, en attendant qu’un des deux rivaux se décidât à lui parler affaires. Le Turc était un bon garçon, honnête, posé et timide. Il parla cependant et fut écouté.
Tout le monde apprit bientôt ce petit événement, excepté maître L’Ambert, qui enterrait un oncle dans le Poitou. Lorsqu’il revint à l’Opéra, mademoiselle Victorine Tompain avait un bracelet de brillants, des dormeuses de brillants et un cœur de brillants pendu au cou comme un lustre. Le notaire était myope; je crois vous l’avoir dit dès le début. Il ne vit rien de ce qu’il aurait dû voir, pas même les sourires malins qui le saluèrent à sa rentrée. Il tournoya, babilla et brilla comme à son ordinaire, attendant avec impatience la fin du ballet et la sortie des enfants. Ses calculs étaient faits: l’avenir de mademoiselle Victorine se trouvait assuré, grâce à cet excellent oncle de Poitiers qui était mort juste à point.
Ce qu’on appelle à Paris le passage de l’Opéra est un réseau de galeries larges ou étroites, éclairées ou obscures, de niveaux forts divers qui relient le boulevard, la rue Lepeletier, la rue Drouot et la rue Rossini. Un long couloir, découvert dans sa plus grande partie, s’étend de la rue Drouot à la rue Lepeletier, perpendiculairement aux galeries du Baromètre et de l’Horloge. C’est dans sa partie la plus basse, à deux pas de la rue Drouot, que s’ouvre la porte secrète du théâtre, l’entrée nocturne des artistes. Tous les deux jours, à minuit, un flot de 300 à 400 personnes s’écoule tumultueusement sous les yeux du digne papa Monge, concierge de ce paradis. Machinistes, comparses, marcheuses, choristes, danseurs et danseuses, ténors et soprani, auteurs, compositeurs, administrateurs, abonnés, se ruent pêle-mêle. Les uns descendent vers la rue Drouot, les autres remontent l’escalier qui conduit par une galerie découverte à la rue Lepeletier.
Vers le milieu du passage découvert, au bout de la galerie du Baromètre, Alfred L’Ambert fumait un cigare et attendait. A dix pas plus loin, un petit homme rond, coiffé du tarbouch écarlate, aspirait par bouffées égales la fumée d’une cigarette de tabac turc, plus grosse que le petit doigt. Vingt autres flâneurs intéressés piétinaient ou attendaient autour d’eux, chacun pour soi, sans nul souci du voisin. Et les chanteurs traversaient en fredonnant, et les sylphes mâles, traînant un peu la savate, passaient en boitant, et, de minute en minute, une ombre féminine enveloppée de noir, de gris ou de marron, glissait entre les rares becs de gaz, méconnaissable à tous les yeux, excepté aux yeux de l’amour.
On se rencontre, on s’aborde, on s’enfuit, sans prendre congé de la compagnie. Halte-là! voici un bruit étrange et un tumulte inusité. Deux ombres légères ont passé, deux hommes ont couru, deux flammes de cigare se sont rapprochées; on a entendu des éclats de voix et comme le bruit d’une rapide querelle. Les promeneurs se sont amassés sur un point; mais ils n’ont plus trouvé personne. Et maître Alfred L’Ambert redescend tout seul vers sa voiture, qui l’attendait au boulevard. Il hausse les épaules et regarde machinalement cette carte de visite tachée d’une large goutte de sang:
Ayvaz-Bey
Secrétaire de l’ambassade ottomane,
Rue de Grenelle Saint-Germain, 100.
Écoutez ce qu’il dit entre ses dents, le beau notaire de la rue de Verneuil:
– La sotte affaire! Du diable si je savais qu’elle eût donné des droits à cet animal de Turc!.. car c’est bien lui … Aussi pourquoi n’avais-je pas mis mes lunettes?.. Il paraît que je lui ai donné un coup de poing sur le nez? Oui, sa carte est tachée et mes gants le sont aussi. Me voilà un Turc sur les bras par une simple maladresse; car je ne lui en veux pas, à ce garçon … La petite m’est fort indifférente, après tout … Il l’a, qu’il la garde! Deux honnêtes gens ne vont pas s’égorger pour mademoiselle Victorine Tompain … C’est ce maudit coup de poing qui gâte tout …
Voilà ce qu’il disait entre ses dents, ses trente-deux dents, plus blanches et plus aiguës que celles d’un jeune loup. Il renvoya son cocher à la maison et se dirigea à pied, au petit pas, vers le cercle des Chemins de fer. Là, il trouva deux amis et leur conta son aventure. Le vieux marquis de Villemaurin, ancien capitaine de la garde royale, et le jeune Henri Steimbourg, agent de change, jugèrent unanimement que le coup de poing gâtait tout.